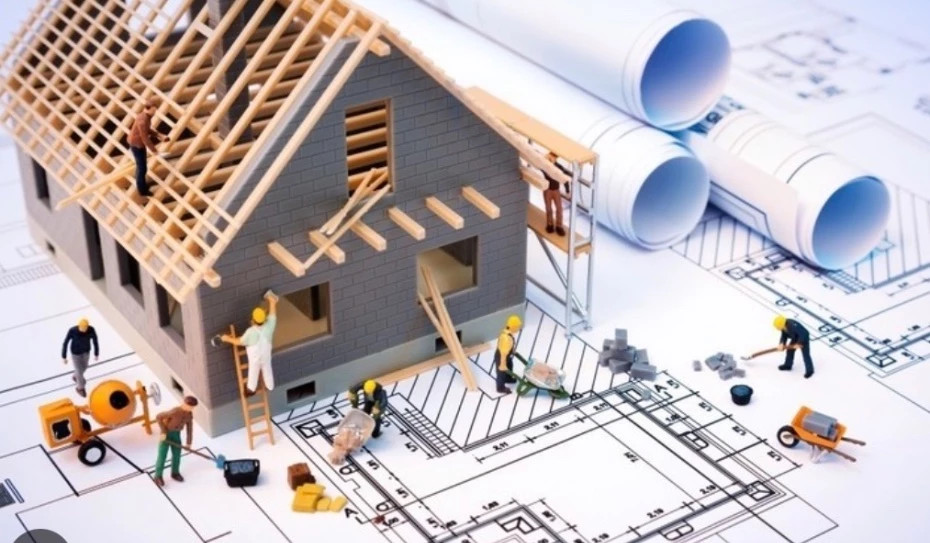Ilyes Bellagha
L'article analyse comment l'urbanisme et l'architecture participative produisent des citoyens passifs plutôt que des acteurs collectifs, en explorant les liens familiaux, locaux et nationaux dans la fabrication de l'espace citoyen.
Introduction
L'urbanisme contemporain se donne souvent des airs de modernité démocratique. On parle de participation citoyenne, d'ateliers ouverts, de co-construction des espaces publics. Pourtant, derrière ces mots séduisants, la réalité est bien plus inquiétante : ce n'est pas l'espace citoyen qui se construit, mais une citoyenneté passive, encadrée et disciplinée. Les habitants sont invités à « participer » pour valider des choix déjà faits, comme si leur rôle se limitait à cocher la case du consentement.
Cette dérive ne vient pas de nulle part. Elle est le fruit d'une idéologie héritée des Lumières, où l'individu fut sacralisé comme mesure de toute chose. L'urbanisme et l'architecture, en se focalisant sur cet individu isolé, ont perdu de vue la réalité : une société ne se résume jamais à la somme de ses parties. Elle est un tissu de liens, une matrice de solidarités et de conflits qui dépassent largement l'échelle individuelle.
Ibn Khaldoun l'avait pressenti avec sa notion d'« asabiyya » : la force d'un groupe réside dans la cohésion et les solidarités qui lient ses membres. Marx l'a confirmé en montrant que les structures économiques et politiques conditionnent les formes mêmes de la vie collective. Ignorer ces vérités, c'est condamner l'urbanisme participatif à n'être qu'une mise en scène, une illusion de démocratie qui masque la centralisation des décisions et l'imposition d'un modèle unique.
La question est donc cruciale : voulons-nous fabriquer des espaces citoyens vivants, ou continuer à produire des citoyens passifs, soumis à l'obéissance sous couvert de participation ?
1. L'illusion de la rationalité individualiste
Le constat est flagrant : l'individualisme domine la pensée urbanistique. Même ceux qui se veulent rationnels ne le sont qu'à l'intérieur d'une bulle où l'individu est sacralisé. Cette approche méthodologique confond observation et vérité scientifique. Elle isole l'homme de ses contextes sociaux, économiques et culturels, et prétend ensuite expliquer ses comportements comme s'il s'agissait d'une expérience de laboratoire. Or, une société réelle ne se laisse pas disséquer en morceaux isolés.
2. La société comme matrice
La société ne peut être comprise que comme une matrice, au sens le plus simple du terme. Une matrice est un tableau d'éléments reliés entre eux : changer une seule valeur, et c'est tout le système qui se transforme. Ainsi, une famille, un quartier, une nation ne sont pas des sommes d'individus, mais des réseaux d'interactions, de solidarités et de tensions. Ibn Khaldoun l'avait parfaitement compris avec sa notion d'« asabiyya », cette force de cohésion qui soude les groupes humains. Sans elle, aucune société ne peut durer.
3. L'oubli du principe de cohérence (Ibn Rochd)
Aujourd'hui, une grande partie de la pensée dominante a oublié le principe d'Ibn Rochd, selon lequel « deux vérités ne peuvent pas se contredire ». Au lieu de rechercher la cohérence, on se satisfait de tautologies. Par exemple, dire que « les citoyens ne participent pas parce qu'ils sont passifs » ne démontre rien. C'est une phrase qui tourne sur elle-même, une roue creuse. La tautologie remplace l'analyse, et l'urbanisme s'enlise dans des discours circulaires où l'on confond axiome et conclusion.
4. L'architecture participative comme obéissance
L'architecture participative est devenue un terrain d'illustration de ces contradictions. Présentée comme une avancée démocratique, elle n'est souvent qu'un processus d'« obéissance déguisée ». On invite les habitants à donner leur avis, mais toujours dans un cadre déjà figé, où les décisions centrales ne sont jamais mises en question. La participation devient alors un rituel : elle rassure les institutions, donne l'illusion de la démocratie, mais n'engendre pas de véritables transformations sociales.
5. L'approche marxiste : dépasser la simplification
Marx avait déjà montré que le groupe social n'est pas une simple addition d'individus. La société est structurée par des rapports de force, des inégalités de pouvoir et des conditions matérielles qui pèsent sur les comportements. Penser que la participation citoyenne peut être « pure » ou neutre, c'est oublier cette réalité. Dans chaque projet urbain, il y a des intérêts divergents, des hiérarchies implicites, des logiques économiques qui façonnent le résultat final. La citoyenneté ne se décrète pas : elle se conquiert.
Conclusion
On ne fabrique pas un espace citoyen avec des procédures technocratiques, pas plus qu'on ne crée une société en additionnant des individus isolés. La citoyenneté n'est pas un décor, ni un slogan, ni une case à cocher dans un atelier participatif. Elle est le produit d'une histoire collective, d'une mémoire partagée, de liens familiaux, locaux et nationaux qui s'entrecroisent pour donner sens au vivre-ensemble.
Continuer à penser l'urbanisme à partir de l'individu sacralisé, c'est condamner la société à la myopie et à la reproduction de modèles stériles. Relancer éternellement une vieille voiture qui n'a jamais démarré, sous prétexte de participation, ne mènera nulle part.
Il est temps de sortir de l'illusion. Penser la société comme une matrice vivante, comme l'enseignaient Ibn Khaldoun, Ibn Rochd et Marx chacun à leur manière, c'est reconnaître que le citoyen ne prend sens que dans ses liens avec les autres. C'est aussi accepter que la véritable participation ne peut être réduite à l'obéissance, mais doit devenir un acte d'émancipation et de création collective.
L'enjeu est clair : voulons-nous des citoyens passifs dans des villes vitrines, ou des citoyens acteurs dans des espaces vivants ? La réponse ne viendra pas d'en haut. Elle dépend de notre capacité à réinventer ensemble les conditions mêmes du commun.